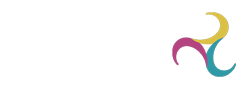24 Sep 2015 | Groupes de travail
Bretagne : se loger ou habiter ?
On envisage parfois le problème de l’habitat sous l’angle du seul « logement ». On constate divers programmes pour financer « le logement social, des « aides à la pierre » pour l’immobilier, de multiples « plans d’investissement pour le logement », des lois pour le « droit au logement opposable » (2002, 2008, etc.).
En provenance d’une racine germanique (initialement un abri humble), le terme de logement prend au Moyen Âge un sens militaire (un « campement pour les troupes ») avant de connaître son acceptation actuelle.
Nous proposerons d’étendre cette acception au terme « d’habiter », plus poreux, qui illustre des formes de percolation avec « le cadre de vie » (G. Rougerie). L’étymologie du terme habitat vient « d’habitare » (vivre, tenir) avec nécessairement un lien renforcé avec l’espace externe parfois pour de simple raison de survie (les tenures). Avec Bourdieu ou Hélias, il est difficile de dissocier ce terme de « l’habitus » (le fait de se socialiser, de laisser une empreinte…) avec de fait la priorisation d’une approche envisageant le logement comme une brique (A.Moles) s’associant à différentes coquilles identitaires (la pièce ou « sa » chambre, le quartier, la ville, la région, le vaste monde…).
En Bretagne, cette exploration touche tout d’abord à l’individu et interroge sur une manière spécifique d’envisager la propriété (18 % de propriétaires de plus qu’en France, l’importance des jardins, le goût supérieur pour l’habitat individuel qu’on attribue parfois à l’héritage rural). L’acquisition d’un logement est-elle une prime à l’autarcie ou un biais pour mieux se socialiser (ancrage, échanges avec les voisins etc.) ? Comment l’accès au logement social peut-il concilier le respect de la vie privée à certaines dynamiques collectives ? Première question : quelle est la nature des porosités à privilégier (ou non) pour établir une forme de contrat spatial ? L’habitat individuel ou en hameaux (ils sont particulièrement nombreux en Bretagne) est-il périmé ou un gage de prospérité ?
Ce questionnement rejoint les questions de gouvernance avec aujourd’hui une prime à la ville compacte et aux logements collectifs. Sous quelles conditions créer de l’habitat collectif ? Quelles sont les initiatives en cours (écoquartiers, locaux ou habitats partagés etc.) qui renforcent leurs utilités ? Comment aussi résoudre l’enjeu de la valorisation de l’ancien (99 % du parc) alors que l’on est souvent focalisé sur le neuf ? Quelles sont les solutions (dans le centre des villes mais aussi en campagne) pour valoriser le patrimoine classé ou inscrit avec un concept de « sauvegarde » qui peine à trouver son équilibre économique ?
La translation du logement vers l’habitat ne passe-t-elle pas par certains programmes, notamment dans l’ancien, privilégiant l’approche d’un habitat économique ? Au-delà du seul fait de « se » loger, qu’en est-il des solutions innovantes permettant de créer des logements productifs, des habitats à énergie positive ? Dans le logement social, sous quelles conditions animer les « communs » (jardins partagés, locaux collectifs…) et valoriser les initiatives existantes ?
Ces dynamiques de solidarité peuvent-elles être compétitives (de la « fête des voisins » à la construction de coopératives de voisinage, le rôle fondamental du numérique pour animer le quartier, l’enjeu des échanges de services intergénérationnels etc.). Quels sont les garde-fous face à ces initiatives séduisantes mais qui font face à des évolutions parfois opposées (le rôle croissant des enclosures) voire créent des ségrégations à une autre échelle (les gated communities, les milices de quartier…) ?
Enfin, sous quelle condition le territoire, notamment en redécouvrant ses ressources, peut-il être à diverses échelles être un levier de ces nouvelles solidarités (construction à proximité du bourg pour le vitaliser, production d’énergie, aides fiscales, modification des règles d’urbanisme, co-financement participatif, gestion et jardin partagés, ré-enchantement du concept de « propriété », échanges ou prêts de foyers et de biens, partages d’objets etc.) ?
La région Bretagne a diverses particularités. Elle est la seule région ayant une structure régionale pour le logement social (l’A.R.O). On y constate la pluralité et un atomisme d’acteurs économiques bien plus nombreux et dispersés qu’ailleurs (pour des raisons géographiques, en raison de l’importance des PME-TPE par exemple dans le secteur du bâtiment). Est-ce un problème, est-ce une chance ? On y constate aussi la présence de singularités sociologiques (elle est avant dernière en France pour les cambriolages, première région pour le tri des déchets, se caractérise par un habitat plus dispersé…). On y constate l’importance supérieure du tissu associatif local, du bénévolat ou de l’économie sociale et solidaire, un enjeu plus fort lié au défi du vieillissement, notamment dans certaines zones rurales. L’isolement, une menace ? Un outil pour mieux vivre ensemble ? Comment favoriser les solidarités territoriales ? Comment, avec des expérimentations concrètes, retrouver le concept « d’homme habitant » (M. Le Lannou) pour incrémenter l’enjeu fondamental du logement par des perspectives enrichies ?
10 Mai 2014 | Groupes de travail
Muscler l’organisation logistique bretonne pour demain
Le transport breton est à 95 % opéré à partir de la route et -malgré les difficultés actuelles- cette réalité permet l’export, le développement des entreprises bretonnes et la conquête de marchés. Toutefois, cette quasi-dépendance à un seul mode n’est pas sans risque pour l’économie. Des modes complémentaires et plus performants restent aujourd’hui négligés, notamment sur les destinations lointaines
Dans le domaine de la mer, alors que la Bretagne est un quai naturel posé sur l’océan et voit passer devant ses portes environ 20 % du trafic maritime mondial, elle ne parvient pas à bénéficier de ces flux qui assurent 95 % du trafic planétaire des marchandises. Le point est d’autant plus paradoxal que l’Irlande, nettement moins bien placée, a doublé son trafic en 10 ans (de 26,5 à 45 millions de tonnes) et parvient à profiter de ces échanges planétaires qui s’envolent (2 566 millions de tonnes en 1970, 4006 millions en 1970, 8 500 millions aujourd’hui). En Bretagne, malgré la présence de la Brittany Ferries, la mondialisation maritime apparaît presque subie, le trafic portuaire des cinq départements bretons étant à 70,9 % consacré aux importations, notamment énergétiques.
Parallèlement, dans le domaine ferroviaire, le fret breton a été nettement négligé malgré différentes études et préconisations[1]. Certes, depuis 2009, les efforts de Combiwest lui ont permis en 2013 de transporter l’équivalent de 25 000 Unités de Transport Multimodal (conteneurs, semi-remorques, caisses mobiles…) et d’autres initiatives apparaissent ou sont en voie de déploiement (la Brohinière, Guingamp…). Toutefois, différents blocages et le coût des « péages » ferroviaires en Bretagne (environ 4 Euros le km) freinent ces développements et les enjeux du fret breton sont pour le moins dépréciés (c’est un euphémisme) au regard du transport des voyageurs. Enfin, soulignons les menaces loin d’être totalement éteintes sur la route (écotaxe, velléités d’instaurer en Bretagne des « péages »…). Si les Bretons ont pour lors résisté à ces nouvelles taxes, la vigilance reste de mise afin de ne pas subir de nouvelles ponctions qui apporteraient un coup fatidique à de multiples entreprises.
Pour toutes ces raisons, Bretagne Prospective propose de mettre en place un groupe de réflexion-action logistique. Nous souhaitons regrouper une poignée de décideurs incontournables. Le groupe n’agrégera que des personnes d’ores et déjà engagées dans l’action et convaincues que la Bretagne doit de manière urgente se saisir d’un enjeu logistique déterminant son avenir.
[1] http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/le-fret-ferroviaire-en-bretagne-a1229.html
11 Déc 2012 | Groupes de travail
« Etudiants-explorateurs – foeterien bro* »
Le groupe international (cinq réunions préparatoires ont été réalisées) est chargé de synthétiser les informations recueillies dans le programme « Etudiants-explorateurs – foeterien-bro ».
Porté notamment par Novincie et Bretagne Prospective et réalisé en partenariat avec les grandes écoles et universités, ce programme va recueillir une masse d’informations internationales en demandant aux étudiants bretons présents à l’étranger de réaliser des « rapports d’étonnement » selon une méthodologie précise. Autour du sujet de la transition énergétique, l’objet du groupe sera donc de brasser et sélectionner ces idées pour en retenir les meilleures et voir en quelle mesure ces solutions innovantes peuvent être diffusées en Bretagne. Le groupe réunira donc des unversitaires, des experts, des chefs d’entreprise et différents acteurs bretons versés dans l’international.
De manière global, l’enjeu est donc la mise en commun de méthodologies et de veille économique à l’international, afin d’irriguer notre territoire, ses décideurs et (surtout) ses jeunes des réalités multiformes du monde économique innovant et de ses courants porteurs à l’échelle internationale
Nos convictions : La Bretagne a toujours été prospère lorsqu’elle était internationale, allant jusqu’à frapper un tiers de l’or français au XVIIe siècle. Renouant avec ce tropisme d’ouverture au monde, le Projet FOETERIEN BRO vise notamment à s’appuyer sur les nouveaux ambassadeurs de la Bretagne, ses étudiants, pour dénicher aux quatre coins du monde des facteurs de sa prospérité pour le XXIe siècle.
Un consortium, pour quoi faire ? De nombreuses institutions et acteurs bretons pratiquent l’intelligence économique internationale. Notre proposition est de nous concerter pour mutualiser nos efforts à trois niveaux : les méthodologies de veille; les analyses de données collectées ; la diffusion et la mise en pratique des résultats lorsqu’ils intéressent des publics larges et/ou des dynamiques collectives.
Comment proposons-nous de fonctionner ? : Notre mode d’action principal est basé sur la réalisation de « rapports d’étonnement » par des étudiants formés et suivis dans leurs explorations, et sur l’exploitation de ces rapports par des collèges de décideurs ad-hoc.
D’autres modes d’actions seront à développer, notamment en associant les enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement partenaires aux travaux d’exploration
Les Trois Etages du dispositif :
Explorer : ce premier étage vise à faire réaliser, in situ ou à distance, par des étudiants formés et suivis, des enquêtes sur des atouts, des succès et des facteurs de créativité de territoires étrangers, avec une restitution structurée sous forme de « rapports d’étonnements ».
Analyser : Le groupe international s’inscrit pleinement dans cette étape. cette seconde phase consiste à exploiter les rapports de la phase I, au sein de ce groupe de décideurs et
d’experts chargés d’en extraire les pistes d’innovation et d’avenir susceptibles d’alimenter des débats régionaux structurants, voire de mener à des applications directes en Bretagne
Entreprendre : Le travail d’investigation et d’échanges au sein du groupe sera valorisé à l’échelle du territoire, d’un secteur d’activité, d’un projet local ou régional, etc… à l’aide d’outils et d’actions idoines.
Le consortium jouera là encore son rôle de mise en commun d’expertises croisées, et de création de consensus pour le succès d’opérations collectives décidées en commun.
Dans ce but, le consortium formalise donc des partenariats notamment avec des :
* Etablissements d’enseignement supérieur offrant un cursus réel ou virtuel à l’étranger
* Entreprises intéressées par des missions individuelles et/ou des explorations collectives sur les marchés et les partenariats à l’étranger,
* fédérations ou groupements organisant des actions de veille internationale ou analogue
* tout autre acteur, public ou privé, engagé dans des réflexions et démarches de même nature
Porteurs et soutiens du programme :
* Etablissements d’enseignement : Agro campus Rennes, Sciences-Po Rennes, ESC Rennes, IGR, Universités Rennes 1 et 2, UBO, INSA Rennes…
* Entreprises : Groupements professionnels, tètes de réseaux dans les domaines de l’Agroalimentaire, technologies de l’information et de l’informatique, Industries navales, industries de la mer, industries automobiles…
* Activités de « société civile » : Contacts en cours avec Locarn, Produit en Bretagne, Bretagne Commerce International, OBE…
Les Initiateurs du Projet :
Bretagne Prospective est une association indépendante, regroupant des représentants de la société civile, des Collectivités Territoriales, des Entreprises, afin de mesurer, partager et formuler des scenarii, puis des Projets, pour le “devenir » du Territoire Breton (énergie, avenir maritime, Equilibre Territorial,..).
Novincie est une association dédiée à la pratique de l’Intelligence économique d’entreprise. Créée en 2006, elle agit en partenariat notamment avec les CCI de Bretagne, l’IHEDN, l’Union des Entreprises ; les établissements de l’Université Européenne de Bretagne, et le REPI (Entreprises et Propriété Industrielle).
Modalité de fonctionnement du groupe international :
En partenariat avec Novincie, des réunions préparatoires ont déjà eu lieu (ambitions, propositions méthodologiques etc.). Objet : avec nos partenaires, quatre réunions de travail une fois que la matière estudiantine sera recueillie.
Elaboration d’une synthèse des nouveaux enjeux bretons concernant notamment la thématique et les défis de la transition énergétique (état des lieux, innovations externes, possibilité ou non de diffusion en interne). Réflexions et relais vers les modalités concrètes d’application dans les territoires (Novincie).